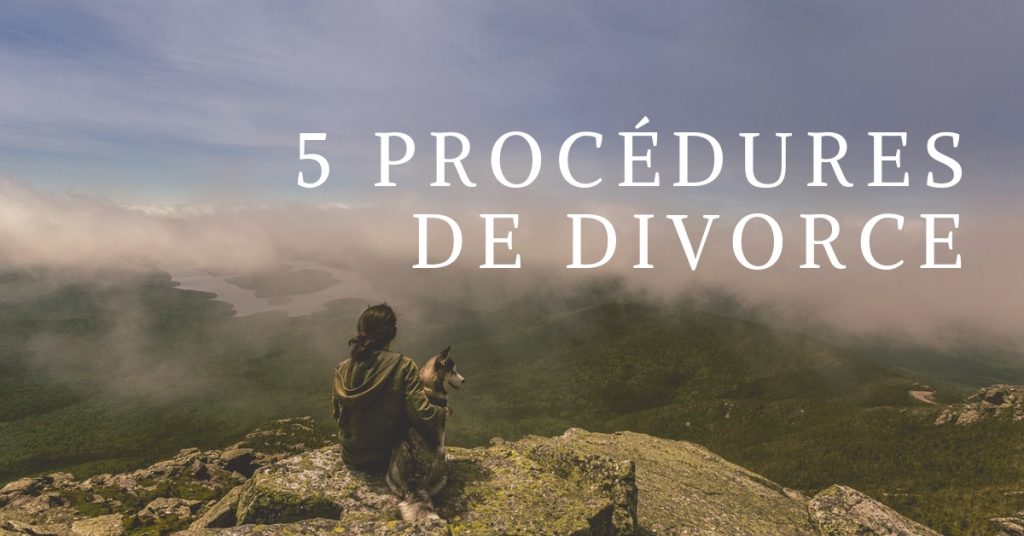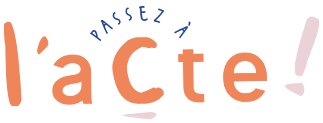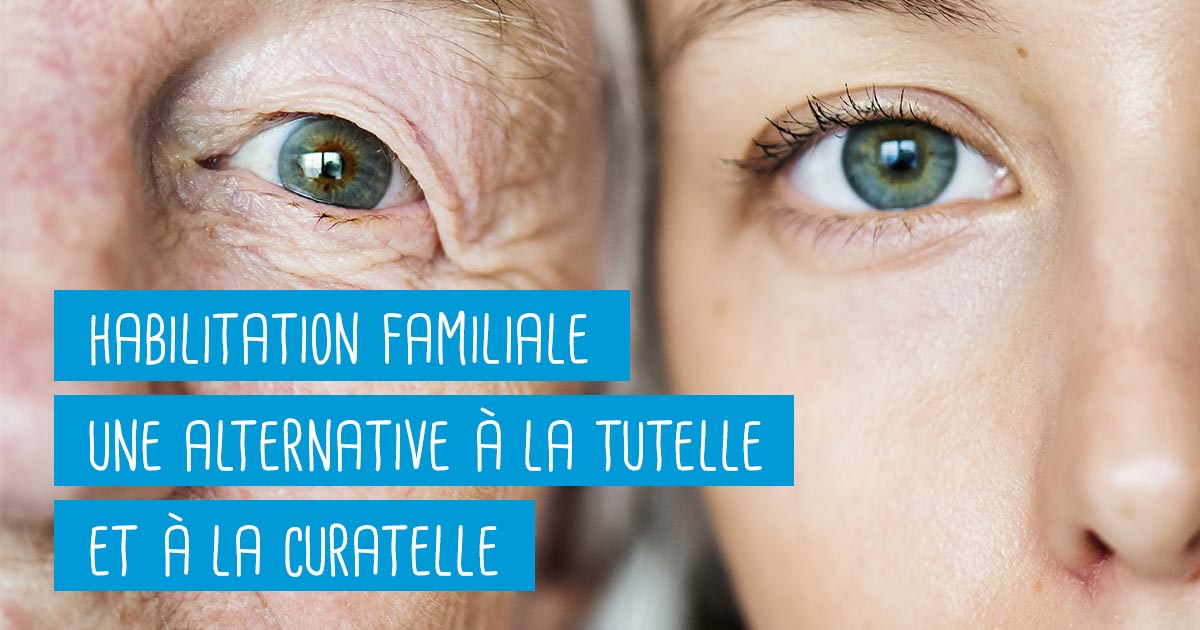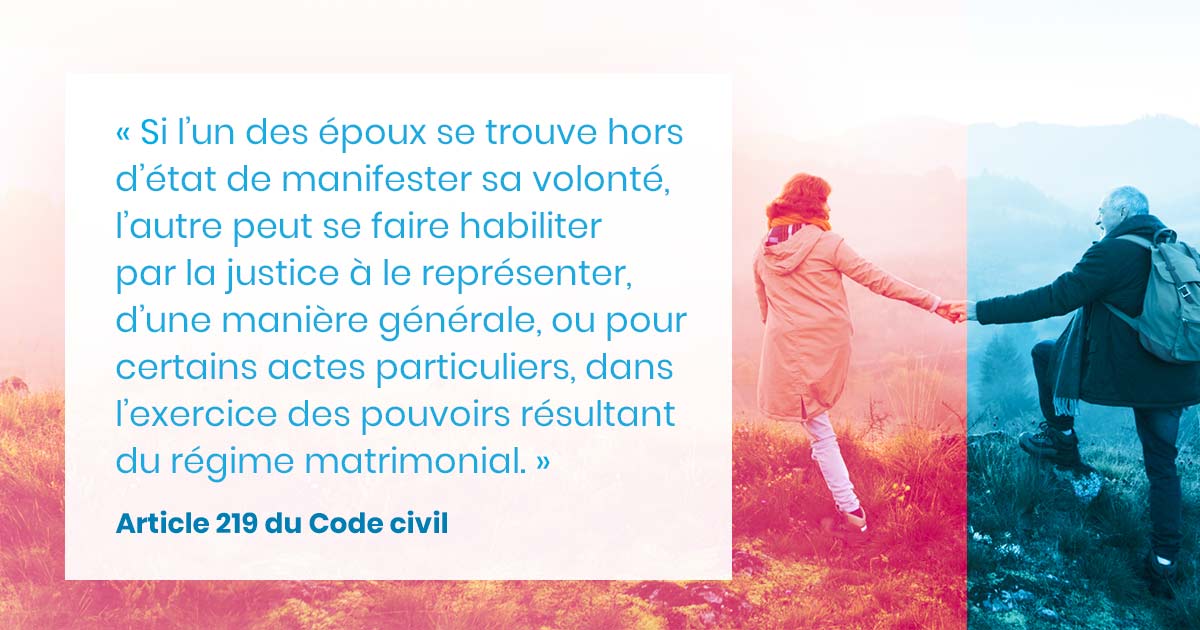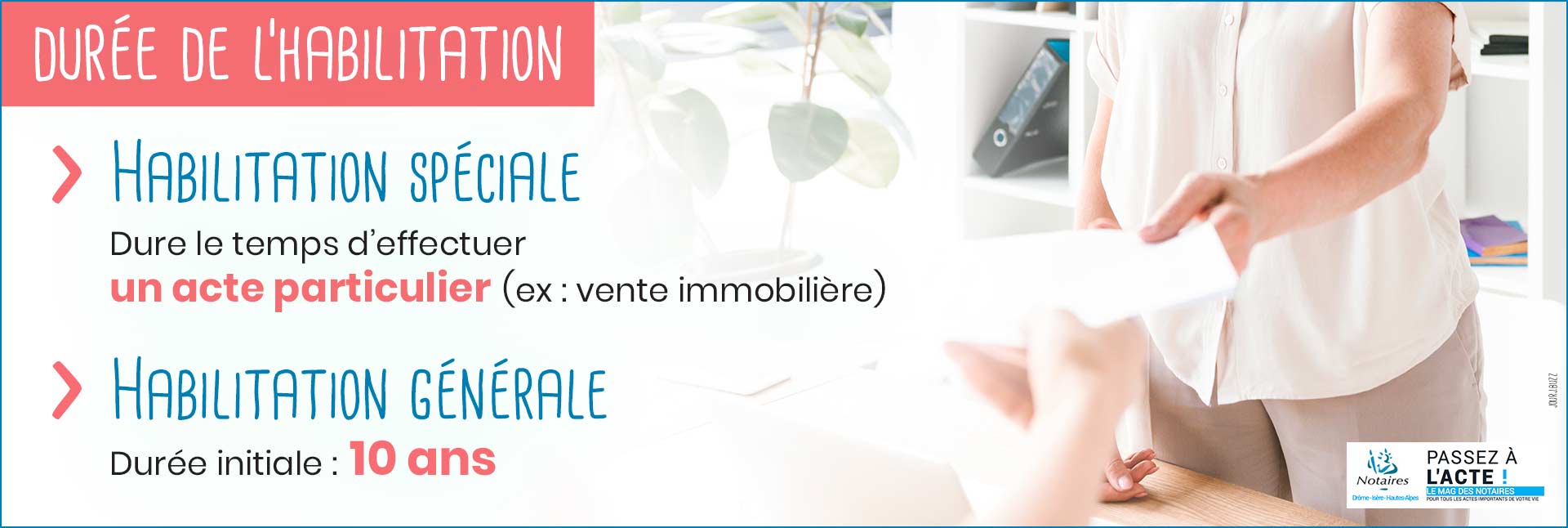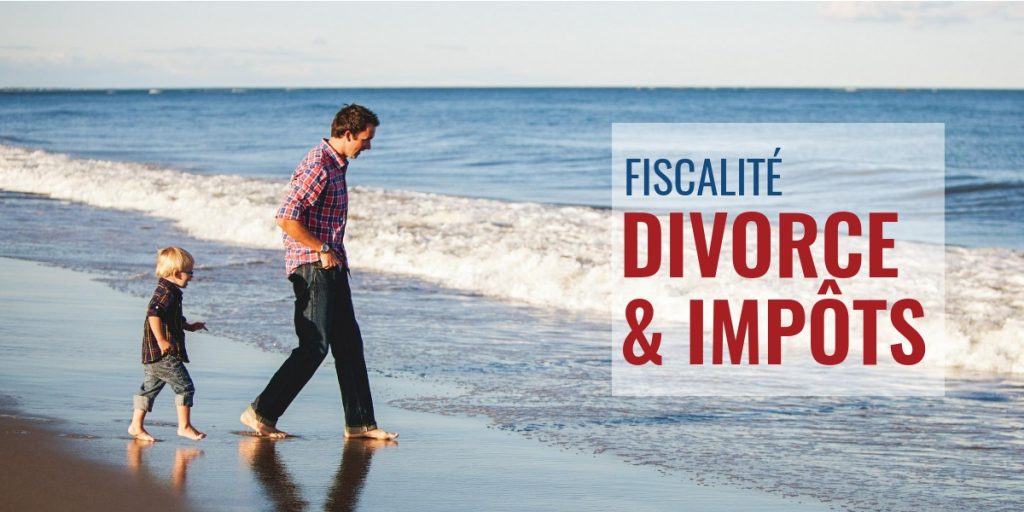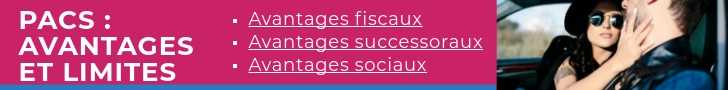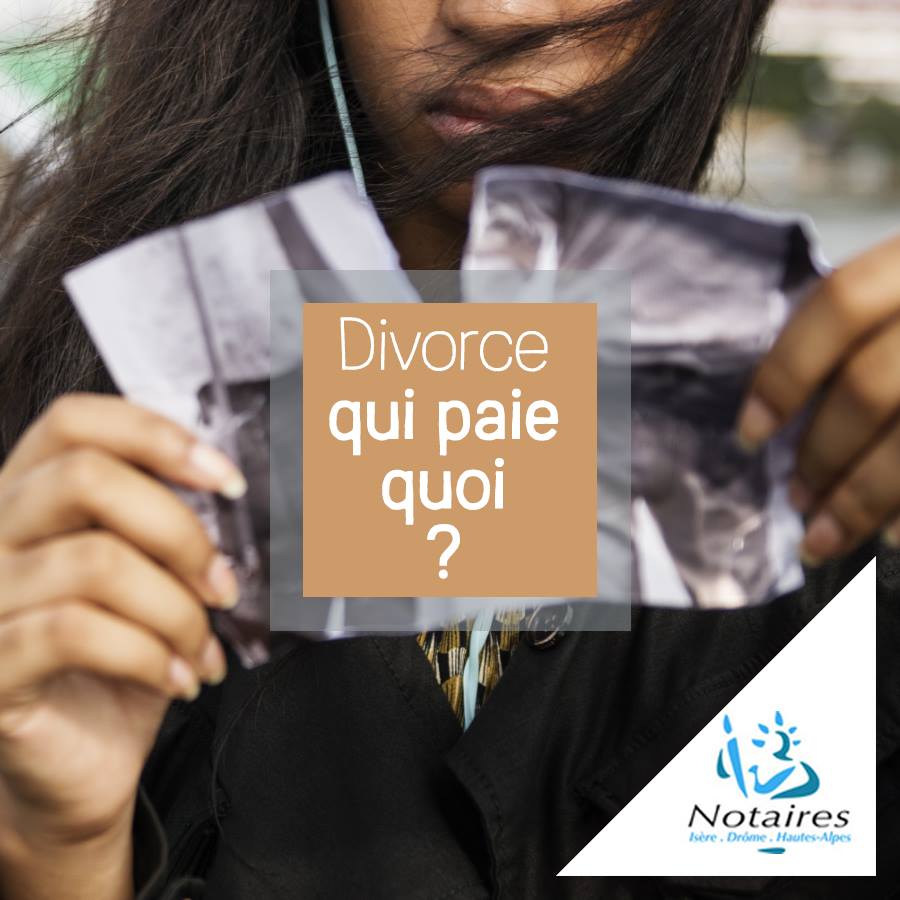Divorcer a des conséquences financières importantes, que le divorce soit amiable ou contentieux. Divorcer engendrera, selon les cas, le versement d’une pension alimentaire pour les enfants, d’une prestation compensatoire pour le conjoint le moins fortuné, la liquidation et le partage des biens du couple, le versement d’indemnité d’occupation, de dommages et intérêts, de divers frais induits par la procédure (huissiers…) et la prise en charge seul, par chacun des membres du couple, de diverses dépenses de la vie courante, qui jusqu’alors étaient payées par les deux.
En tout état de cause, le divorce nécessitera d’avoir recours à deux avocats, y compris dans le cadre du divorce sur consentement mutuel depuis le 1er janvier 2017, et chaque époux devra assumer les honoraires libres de l’avocat qu’il mandatera pour représenter ses intérêts.
A lire également, notre article sur rôle du notaire dans une procédure de divorce.
Divorcer quand on a des enfants : la pension alimentaire
Le Code civil met à la charge des parents l’entretien et l’éducation des enfants en proportion de leurs ressources respectives. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants.
En cas de divorce, la pension alimentaire consiste en une somme d’argent versée par un parent à l’autre parent en exécution de cette obligation alimentaire. Ce versement peut être ordonné par le juge dès la procédure de divorce, au titre des mesures provisoires.
Le montant de la pension alimentaire est fixé entre les parties, ou en cas de désaccord, par le Juge aux Affaires Familiales. Dans ce cas, il sera tenu compte des ressources de l’époux débiteur essentiellement. La pension alimentaire peut être révisée à la demande de l’un des ex-conjoints si un changement important de situation est apparu ou si les enfants ont des besoins différents.
Divorcer quand les situations financières des époux sont disparates : la prestation compensatoire
Lorsque les situations financières et patrimoniales des époux sont disparates, le conjoint le moins fortuné pourra solliciter une prestation compensatoire (lire notre article complet sur le mode de calcul de la prestation compensatoire). Comme son nom l’indique, elle est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».
Son montant et les modalités de son versement sont convenus par les époux ou à défaut par le Juge aux Affaires Familiales. Dans ce cas, le juge va procéder à un examen global de la situation patrimoniale des époux, en tenant compte de l’avenir prévisible.
Les critères d’évaluation sont :
• la durée du mariage
• l’âge et l’état de santé des époux
• la situation professionnelle des époux et leur qualification
• les sacrifices professionnels faits par l’un des époux
• les revenus, le patrimoine des époux, et leur évolution probable
• Les montants des pensions de retraite, actuels ou futurs.
La prestation compensatoire (lien vers article prestation compensatoire calcul en cas de divorce) est versée sous la forme d’un capital et en une fois. A défaut pour le débiteur de pouvoir s’en acquitter en une fois, elle sera versée de manière échelonnée sur une durée ne pouvant excéder huit ans.
A titre exceptionnel, le juge peut fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère sur la tête du créancier.
Dans le cadre d’un divorce amiable, les époux sont libres de prévoir le payement par la remise d’un bien immobilier par exemple.
Si la prestation revêt la forme d’une rente, les époux pourront demander au juge de réviser les modalités de versement en cas de changement significatif de leur situation.

Divorcer et occuper le domicile conjugal : l’indemnité d’occupation du logement
La séparation du couple précède généralement le divorce. Le plus souvent, l’un des conjoints occupera seul le domicile conjugal préalablement à sa vente ou son attribution à l’un d’eux. La jouissance du domicile au profit d’un des conjoints figure parmi les mesures provisoires prononcées par le juge dans le cadre d’une procédure contentieuse. Le juge précisera si la jouissance du bien sera gratuite ou si au contraire elle donnera lieu au versement d’une indemnité d’occupation assimilable à un loyer.
Le plus souvent le payement de cette indemnité se fait lors du partage des intérêts pécuniaires du couple et se déduit de la part attribuée à l’époux débiteur.

La liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts pécuniaires
Dans le cadre du divorce sur consentement mutuel :
Depuis le 1er janvier 2016, le divorce amiable est devenu le divorce sans juge.
Le divorce par consentement mutuel ne peut avoir lieu si le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande à être auditionné par le juge ; et si l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes des majeurs protégés.
La demande peut être faite si les époux sont d’accord sur le principe du divorce, le partage des biens, l’autorité parentale, la pension alimentaire et la prestation compensatoire.
L’avocat adresse à l’époux qu’il assiste, par lettre recommandée avec accusé de réception, un projet de convention. Ce projet ne peut pas être signé par les époux avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de 15 jours à compter de la réception. Si l’un des époux signe la convention avant le délai de 15 jours, la convention devient nulle.
Cette convention prend la forme d’un acte sous seing privé contresigné par chacun des avocats des époux.
Elle est signée par les époux et leurs avocats en 3 exemplaires. Chaque époux conserve un original de la convention accompagnée de ses annexes. Le 3e original est pour le notaire.
La convention est transmise au notaire dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention.
Jusqu’au dépôt de la convention chez un notaire, les époux peuvent saisir le TGI d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire.
La convention doit être ensuite être remise à un notaire qui la déposera au rang de ses minutes.
Le notaire contrôle si les éléments obligatoires apparaissent dans la convention et si le délai de réflexion de 15 jours a bien été respecté.
Le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire permet de conférer à la convention date certaine et force exécutoire. La convention est applicable immédiatement, sauf stipulation contraire des époux.
La convention fixe la répartition des frais du divorce entre les époux. La convention ne peut pas mettre à la charge de la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle plus de la moitié des frais du divorce.
Le coût du divorce variera en fonction des honoraires libres des avocats choisis.
Le dépôt au rang des minutes du notaire de la convention s’élève à 42 € hors taxe (50,4 € TTC).
Les frais relatifs à l’acte notarié peuvent venir s’ajouter si la convention comporte un état liquidatif relatif à des biens immobiliers, ou le règlement d’une prestation compensatoire par la remise de biens immobiliers. Le coût de l’acte dépend principalement des capitaux traités. Il représente les émoluments (rémunération tarifée du notaire), les débours, et les droits et taxes (notamment le droit de partage de 1,8 % (taux au 1er janvier 2021) dû à l’Administration fiscale).
Dans le cadre du divorce contentieux
Dans le cadre des divorces conflictuels, le Juge aux Affaires Familiales qui prononce le divorce ordonne la liquidation des droits des époux et le cas échéant le partage de leurs intérêts pécuniaires.
S’il existe des biens immobiliers, un notaire devra dresser cet acte.
Le coût de l’acte sera déterminé de la même manière que pour le divorce amiable.
Il sera toujours possible d’acter un accord s’il intervient en cours de procédure.
Divorcer et être en conflit : le versement de dommages et intérêts dans le cadre d’un divorce conflictuel
Le Juge aux Affaires Familiales peut ordonner le versement, par l’époux aux torts duquel le divorce est prononcé, de dommages et intérêts au profit de l’autre époux, si celui-ci subit un préjudice très significatif dans le cadre du divorce, en application et dans les conditions de l’article 266 du Code civil.
Un époux peut également demander le versement de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
La réparation est alors justifiée non pas par le divorce, mais par suite des préjudices causés par le comportement fautif du conjoint.
Divorcer, et après ? Le coût de la vie après le divorce
La séparation engendre des dépenses supplémentaires dans la vie courante.
Seul le salaire de l’époux divorcé doit lui permettre d’assumer toutes les dépenses.
Le divorce entraine aussi la séparation du foyer fiscal.
Désormais les époux seront imposables individuellement.
Franck VANCLEEMPUT, notaire
En savoir plus
En complément de cet article :

EnregistrerEnregistrer
EnregistrerEnregistrer
EnregistrerEnregistrer
EnregistrerEnregistrer
EnregistrerEnregistrer
EnregistrerEnregistrer